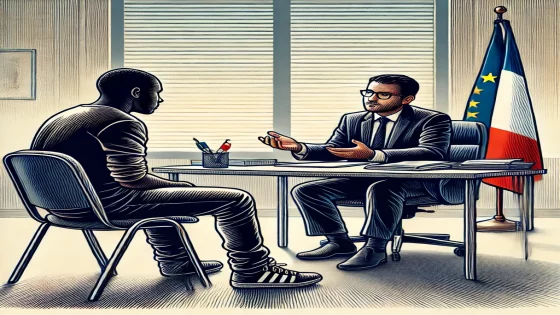En 2023, la France a enregistré 142 496 demandes de protection internationale, reflétant l’importance de comprendre les démarches pour solliciter une protection internationale.
ofpra.gouv.fr Ce guide détaille les étapes essentielles de la procédure de demande d’asile en France, en intégrant les récentes modifications législatives et les données actuelles.
1. Arrivée sur le territoire français
Pour initier une demande d’asile, il est impératif d’être physiquement présent en France. Cependant, l’accès au territoire français demeure un défi majeur en raison de l’absence de voies légales et sûres pour les personnes fuyant les persécutions. Cette situation contraint de nombreux individus à emprunter des routes dangereuses, souvent au péril de leur vie.
2. Enregistrement de la demande d’asile
Une fois en France, le demandeur doit enregistrer sa demande auprès des autorités compétentes. La loi promulguée le 26 janvier 2024 prévoit le déploiement progressif de pôles territoriaux dénommés « France asile », après la mise en place de trois sites pilotes, en remplacement des guichets uniques pour demandeurs d’asile (GUDA).
vie-publique.fr Ces pôles regroupent la préfecture, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et un représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Cette configuration vise à centraliser les démarches et à recueillir directement le récit du demandeur, supprimant ainsi l’obligation de remplir un formulaire écrit.
3. Instruction de la demande par l’OFPRA
L’OFPRA est chargé d’examiner les demandes d’asile. Avec la réforme de 2024, l’instruction des dossiers a été modifiée pour permettre une meilleure gestion des demandes. Notamment, l’abandon du lieu d’hébergement par le demandeur peut désormais entraîner la clôture de sa demande par l’OFPRA, en plus de la perte des conditions matérielles d’accueil.
4. Décision de l’OFPRA
Après examen, l’OFPRA peut soit accorder le statut de réfugié, soit une protection subsidiaire, soit rejeter la demande. En cas de rejet, le demandeur dispose d’un délai pour contester la décision.
5. Recours devant la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA)
En cas de refus de l’OFPRA, le demandeur peut saisir la CNDA. La réforme de 2024 a introduit des changements significatifs dans cette procédure : désormais, toutes les affaires sont jugées par un juge unique, et des chambres territoriales de la CNDA peuvent être établies dans certaines régions pour faciliter l’accès à la justice.
6. Accueil et conditions matérielles
Les demandeurs d’asile ont droit à un hébergement et à une aide financière pendant l’instruction de leur demande. Cependant, le projet de loi de finances pour 2025 prévoit la suppression de 6 000 places d’hébergement dédiées aux demandeurs d’asile, réduisant le parc à 113 258 places. Cette diminution pourrait affecter les conditions d’accueil et accentuer la vulnérabilité des demandeurs.
7. Intégration ou éloignement
Si la protection est accordée, le réfugié bénéficie de droits similaires à ceux des citoyens français, incluant l’accès au travail, à la santé et à l’éducation. En cas de rejet définitif, le demandeur est susceptible de recevoir une obligation de quitter le territoire français (OQTF). La réforme de 2024 a étendu le délai de recours contre une OQTF de 15 jours à un mois, offrant ainsi plus de temps pour contester cette décision.
Il est essentiel de noter que la procédure d’asile en France est en constante évolution, influencée par des réformes législatives et des décisions politiques. Les demandeurs sont donc encouragés à se tenir informés des dernières dispositions et à solliciter l’assistance d’organismes spécialisés pour les accompagner dans leurs démarches.
Sources